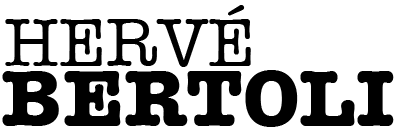L’ATTENTAT
J’ouvre les yeux. Je suis allongé sur le dos. Au dessus de moi une toile. Blanche, laiteuse. «Où suis-je ?» Je cherche mais tout est confus dans ma tête. Je me redresse, je regarde autour de moi. Je découvre une grande toile de tente, toute en longueur. De part et d’autre, des lits de camp sont alignés. Une simple toile, tendue entre deux bras métalliques. Sur plus de la moitié des lits, il y a des corps allongés. Au fond, sur la droite, des femmes en tenues blanches s’affairent auprès d’un homme, les vêtements en lambeaux. Des infirmières ! Mon cerveau se remet doucement en route. Je suis dans un hôpital de campagne. A travers la toile, je devine les lumières bleues et rouges des gyrophares. «Que s’est-il passé ?» Soudain, comme si on venait de me retirer des bouchons d’oreilles, les sons me parviennent. J’entends des pleurs, des cris de souffrance, des ordres qui fusent, des bruits de pierres qui roulent et de métal qui grince.
Deux pompiers entrent dans la tente. Ils soutiennent une femme enveloppée dans une couverture de survie. Elle a du sang partout. Comme si sa vie en dépendait, elle tient fermement sa sacoche d’ordinateur.
En voyant la mallette, tout me revient d’un coup : le bureau, la pause à la machine à café, les collègues, les rires. Et la seconde suivante, l’horreur. Comme dans un film, je revois le fil des événements : Le sol qui se met soudainement à vibrer ; les boites de documents et les classeurs, qui chutent des armoires dans le bureau voisin ; les cris, la panique ; puis très vite, les éclairages qui s’écroulent du plafond, les armoires qui basculent au sol, les vitres des fenêtres qui éclatent, les cloisons qui cèdent sous la pression, le plancher qui s’ouvre et les corps qui plongent dans le vide… «Que s’est-il passé ? Un attentat ? Un tremblement de terre ?».
Un nouveau pompier surgit en poussant un fauteuil roulant. La femme assise dessus à l’air en état de choc. Les infirmières se précipitent à leur rencontre. La femme soutient son bras droit et semble ne pas avoir remarqué que sa main est absente. Un pansement de fortune enveloppe son avant-bras. Ses cheveux roux me font penser à la fille de la compta qui bosse avec… Lucie ! L’émotion me fait vaciller sur le lit. Lucie ! Mon épouse travaille à la compta. Les idées se bousculent dans ma tête, j’ai du mal à raisonner. «Quel jour on est ? Est-ce qu’elle travaillait aujourd’hui ?» Je n’arrive pas à me souvenir ! Tout est confus. Il faut que je la trouve, que je demande à quelqu’un. Je saute du lit et je manque m’écrouler par terre. Je tangue jusqu’au lit d’en face et je m’accroche au montant pour ne pas tomber. Au fond de la tente, les infirmières ne font pas attention à moi. Elles sont occupées avec la femme à la main arrachée. Sur le brancard où je suis appuyé, un homme est étendu. Il a la poitrine enfoncée et le côté gauche de son visage n’est plus qu’une plaie. Une feuille de papier est coincée sous son bras. Un nom est écrit dessus. Le sien vraisemblablement. Je comprends brusquement que cette toile de tente n’est pas qu’un hôpital de campagne où l’on donne les premiers soins. Elle accueille aussi les victimes sorties des décombres. J’avance dans l’allée en prenant appui aux lits. Les blessés sont mal en point. La femme allongée sous mes yeux est couverte de bandages ensanglantés. Elle me regarde fixement, l’oeil vide. La vie semble s’échapper d’elle au rythme de ses râles de souffrance. Je prends soudain conscience de mon propre état. Je m’arrête entre deux brancards et j’entreprends un examen de mon corps. Avec surprise, je découvre ma nudité, qui révèle une absence totale de blessures. Je n’ai rien. Pas une égratignure. Je palpe mon corps et ne ressens aucune douleur. Avec angoisse, je touche délicatement ma tête, m’attendant à rencontrer un pansement ou des bandages poisseux de sang. Mais non, rien. Juste mes cheveux. Je suis totalement indemne ! Je regarde autour de moi, tout ces corps mutilés, ces blessés, ces morts. «Je suis le rescapé de l’accident. Celui qui dans chaque catastrophe s’en sort sain et sauf. Le miraculé !» J’ai envie de crier ma joie mais l’image de mon épouse surgit dans ma tête. Un sentiment d’urgence m’envahit. «Il faut que je retrouve Lucie !» Je regarde le lit face à moi. Un homme gît dessus. Mort. Il n’a pas de blessure apparente. Je le reconnais immédiatement et le nom que je lis sur la feuille posée sur son ventre, me confirme son identité. Il s’agit de Jean Bassin, l’homme qui m’a recruté il y a cinq ans. Un brave type que j’avais apprécié tout de suite. A l’époque j’avais deux belles opportunités d’emploi et je me souviens encore de ce qu’il m’avait dit à la fin de l’entretien : «Monsieur Tendron, Marc. Je peux vous appeler Marc ? Signez chez nous, je vous promets que vous ne le regretterez pas». Il ne s’était pas trompé, je ne l’ai jamais regretté. D’autant plus que c’est là que j’ai rencontré Lucie. «Il faut que je la retrouve !». Je traverse l’allée centrale pour examiner les brancards de l’autre côté. Sous mes yeux, deux autres corps sans vie. Celui de droite a le bras tendu hors du lit. Il est dénudé et révèle une cicatrice en forme de croissant de lune avec un grain de beauté de chaque côté. Une marque unique. Reconnaissable entre mille. Un dessin que je connais par coeur. La réalité m’éclate au visage. Mes yeux s’embuent de larmes. J’étouffe un sanglot. Le chagrin m’envahit et me submerge. Combien de fois ai-je passé mon index sur ce croissant ? Lucie se moquait de moi et me disait : «en fait tu l’adores cette cicatrice». Lucie ! Plus jamais je ne te tiendrai dans mes bras. Plus jamais je ne sentirai l’odeur de ta peau. Lui avais-je seulement dit je t’aime ce matin ? Je suis dévasté. Je n’arrive pas à y croire. Mon regard tombe sur la feuille d’identification posée au bas du lit. L’horreur y est inscrite en lettres bâtons : MARC TENDRON